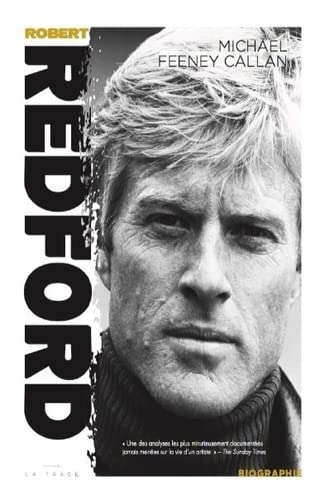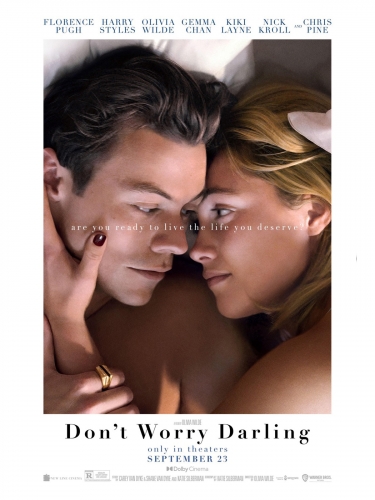Bilan et palmarès du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2023

Selon Simone de Beauvoir, « Il existe des procédés magiques qui suppriment les distances de l'espace et du temps : les émotions. » Quand, début septembre, l'été expire ses dernières lueurs, chaque année, les émotions deauvillaises les ravivent avec cet incontournable rendez-vous, supprimant la distance le séparant de l’édition précédente, d’autant plus avec ce 49ème Festival au programme passionnant, nullement altéré par les absences (pour cause de grève à Hollywood) de ceux qui auraient dû être à l'honneur cette année, récipiendaires de Deauville Talent Awards : Natalie Portman, Jude Law, Joseph Gordon-Levitt, Peter Dinklage.
Comme chaque année, ce festival fut le reflet des ombres et lumières de la société américaine, et nous a offert une plongée réjouissante et/ou angoissante dans ses tourments et ses espoirs, avec 80 films en sélection officielle.
Après quelques notes enchanteresses de Kyle Eastwood, Guillaume Canet, président du jury, a rendu hommage au cinéaste Jerry Schatzberg comme son « ami et père spirituel » qui « représente le festival indépendant américain » L’occasion aussi de découvrir le documentaire que lui consacre Pierre Filmon, un plan-séquence qui met en exergue la richesse, la profondeur, la diversité du travail du photographe qui parvient toujours à capter la vérité des êtres.
Dans le cadre de Fenêtre sur le cinéma français, 3 œuvres françaises furent projetées en première mondiale dont Icon of french cinema de Judith Godrèche. L'Heure de la Croisette a mis en lumière trois films de la sélection officielle du dernier Festival de Cannes :
- Le Prix du jury, Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, petit bijou de poésie mélancolique d’une drôlerie désespérée, irradié de musique.
- Le règne animal de Thomas Cailley. Film hybride, audacieux, intelligemment métaphorique, teinté d’humour, récit initiatique, fable cauchemardesque d’une force rare mais aussi fim tendre sur la relation entre un père et son fils. Une auscultation de l’animalité de l’homme mais aussi une ode à la différence.
- L’enlèvement de Marco Bellochio. Fresque fascinante, opéra baroque, tragique et flamboyant, filmé dans un clair-obscur fascinant. Plaidoyer contre la folie religieuse et les fanatismes.
Le chef-d’œuvre de ce festival fut La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer, Grand Prix du dernier Festival de Cannes. Cela commence par un écran noir tandis que des notes lancinantes et douloureuses viennent nous avertir que la sérénité qui lui succèdera sera fallacieuse. La première scène nous donne à voir une image bucolique, et Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, qui habite avec sa famille dans une villa avec jardin, derrière les murs du camp. Un air de gaieté flotte dans l’air. C’est dans cette banalité que réside toute l’horreur, omniprésente, dans chaque son, chaque arrière-plan, chaque hors-champ. Cette zone d’intérêt, ce sont les 40 kilomètres autour du camp, ainsi qualifiés par les nazis. Une qualification qui englobe déjà le cynisme barbare de la situation. L’arrière-plan teinte d’horreur tout ce qui se déroule au premier. La vie est là dans ce jardin, entre le père qui fume, les pépiements des oiseaux et les cris joyeux des enfants, éclaboussant de son indécente frivolité la mort qui sévit constamment juste à côté. La « banalité du mal » définie par Hannah Arendt dans chaque plan. Jonathan Glazer prouve d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement. Cette image qui réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent et dont l’un est une insulte permanente à l’autre est absolument effroyable. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. Un choc cinématographique. Un choc nécessaire. Pour rester en alerte. Pour ne pas oublier les victimes de l’horreur absolue mais aussi que le mal peut prendre le visage de la banalité. Un film brillant, glaçant, marquant, incontournable.
Cette dichotomie permanente entre ce vacarme et l’indifférence me rappelle le formidable travail sur le son dans Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, prix d’Ornano-Valenti 2021, prix cette année dévolu au premier long-métrage de fiction de la documentariste Delphine Deloget, Rien à perdre, magnifique portrait de femme prise au piège de mécanismes et d’une réalité qui la dépassent. Virginie Efira incarne une mère dont le fils se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer. Ce film nous tient en haleine de la première à la dernière seconde, en empathie avec cette mère aimante, qui révèle peu à peu ses zones d’ombre. Un film bouleversant qui met en exergue les dysfonctionnements d’une machine administrative rigide et implacable.
Le festival propose aussi désormais des « conversations avec... ». Luc Besson (à l'occasion de la première de son film Dogman) et Carole Bouquet (pour Captives de Arnaud des Pallières) furent cette année à l’honneur.
Les 14 films en compétition officielle (dont 9 premiers films) ont dressé le tableau de l’état (délabré souvent, et en quête d’espoir) des États d’Amérique.
Pour succéder à Aftersun de Charlotte Wells, film gracieux, d’une délicatesse mélancolique qui charrie la beauté fugace de l’enfance et la saveur inégalable de ses réminiscences (floues), il fallait un film aussi réjouissant et extravagant que LaRoy de Shane Atkinson qui a raflé le Grand Prix, le Prix du Public et le Prix de la Critique. Ce thriller teinté d'humour noir, tel celui des frères Coen, débute ainsi : un homme prend en stop un automobiliste en panne qui sous-entend qu’il est peut-être un tueur, quand son chauffeur émet la même hypothèse. Des dialogues savoureux. Une musique de Delphine Malausséna, Rim Laurens et Clément Peiffer. Le décor de cette petite ville trompeusement sereine dissimulant l’excentricité et le chaos intérieur des êtres. Un bijou entre comédie et thriller. Jubilatoire.
Selon Baudelaire, « La mélancolie est l’illustre compagnon de la beauté. Elle l’est si bien que je ne peux concevoir aucune beauté qui ne porte en elle sa tristesse. » L’oublié du palmarès, Past lives – nos vies d’avant de Celine Song illustre parfaitement ces mots. Un film d’une mélancolie subrepticement envoûtante. Dans cette époque de fureur, de course effrénée et insatiable au résultat et à l’immédiateté, y compris dans les sentiments, ce refus du mélodrame, de l’explicite et de l’excès, n’est pas du vide, mais au contraire un plein de sensations et troubles contenus qui nous enveloppent, nous prennent doucement par la main, jusqu’à la fin, le moment où surgit enfin l’émotion, ravageuse. Les notes cristallines, jamais redondantes ou insistantes, accompagnent le mystère qui lie les personnages, magnifient leurs silences et subliment l’implicite. Ce film tout en retenue, ensorcelante, est un joyau de pudeur, de subtilité, d’émotions profondes que l’on emporte avec soi une fois la porte de Nora refermée, et celle de son cœur avec, une fois celui-ci s'étant laissé brusquement envahir et submerger.
Ont été récompensés du Prix du jury, The Sweet East de Sean Price Williams et Fremont de Babak Jalali, L’histoire d’une réfugiée afghane de 20 ans, qui travaille pour une fabrique de fortune cookies. Le portrait d’une femme immigrée et solitaire, fière, combattive, déterminée, indépendante, rêveuse. Le mode de filmage, en 4/3, en plans fixes et en noir et blanc, poétise la mélancolie intemporelle qui émane de son personnage, lui procure de l’élégance, une douceur qui rassérène. On ressort de ce film salutairement lent et délicat, aux accents kaurismäkiens et jarmuschiens, comme l’on quitte ce festival : à regret et le cœur illuminé par les possibles de l’avenir.
PALMARES COMPLET
Le Jury de la 49ème édition du Festival du cinéma américain de Deauville, présidé par Guillaume Canet, entouré d’Alexandre Aja, Anne Berest, Laure de Clermont-Tonnerre, Léa Mysius, Marina Hands de la Comédie-Française, Rebecca Marder, Stéphane Bak et Maxim Nucci alias Yodelice a décerné les prix suivants :
Grand Prix
LAROY de Shane Atkinson
(distribution : ARP Sélection)
En salles en avril 2024
Prix du Jury
THE SWEET EAST de Sean Price Williams
(distribution : Potemkine Films)
Prix du Jury
FREMONT de Babak Jalali
(distribution : JHR Films )
En salles le 6 décembre 2023
Le Jury de la Révélation de la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, présidé par Mélanie Thierry, entourée de Julia Faure, Pablo Pauly, Ramata-Toulaye Sy, Félix Lefebvre, et Cécile Maistre-Chabrol a décerné les prix suivants :
Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation 2023
THE SWEET EAST de Sean Price Williams
(distribution : Potemkine Films)
Prix du Public de la Ville de Deauville
LAROY de Shane Atkinson
(distribution : ARP Sélection)
En salles en avril 2024
Le Jury de la Critique, composé de cinq journalistes, a décerné son Prix à
LAROY de Shane Atkinson
(distribution : ARP Sélection)
En salles en avril 2024
Prix d’Ornano-Valenti 2023
RIEN À PERDRE de Delphine Deloget
(distribution : Ad Vitam)
En salles le 22 novembre 2023